
Le recours aux serious games s’est considérablement développé dans les environnements éducatifs et professionnels, au croisement du jeu vidéo, de la pédagogie active et des sciences cognitives. Mais qu’est-ce qui rend ces jeux sérieux si efficaces pour transmettre un savoir ou développer des compétences ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser les leviers pédagogiques qui s’activent lors de leur utilisation. Motivation, engagement, mémorisation… Autant de dimensions essentielles que les neurosciences contribuent à éclairer.
Mais d’abord, un serious game, c’est quoi ?
Le terme serious game, ou jeu sérieux en français, désigne un jeu dont la finalité dépasse le simple divertissement. Il intègre une intention pédagogique, informative, formatrice ou comportementale. Autrement dit, il s’agit d’un jeu conçu pour apprendre, sensibiliser, entraîner ou former, tout en s’appuyant sur les ressorts ludiques du jeu vidéo. Mais contrairement à une idée reçue, les serious games comme ici ne sont pas une invention récente. Leur origine remonte bien avant l’ère numérique, et leur évolution accompagne celle des technologies éducatives et des besoins sociétaux.
Des prémices militaires aux univers numériques
On situe les premières formes de serious games au début du XXème siècle, avec des jeux de guerre utilisés pour la formation stratégique. En 1947, aux États-Unis, l’armée développe le “war game” “Cold War Game”, une simulation stratégique à but d’entraînement militaire. Cette approche est ensuite raffinée par des institutions comme le Pentagone, qui utilisera des jeux de simulation jusqu’à nos jours pour former les officiers à la prise de décision en contexte complexe.
Le concept de “serious game” tel qu’on l’utilise aujourd’hui a été formalisé bien plus tard. Il est attribué à Clark C. Abt, chercheur américain qui publie en 1970 un ouvrage intitulé “Serious Games”. Il y défend l’idée que les jeux peuvent servir des objectifs éducatifs, sociaux ou politiques, et qu’ils ont leur place dans les dispositifs d’apprentissage structurés.
L’essor numérique et la reconnaissance académique
Avec l’arrivée des ordinateurs personnels dans les années 1980 et des premières consoles de jeux vidéo, les applications éducatives se multiplient. Des jeux comme “The Oregon Trail” (1971, développé au Minnesota Educational Computing Consortium) ou “SimCity” (1989, Maxis) sont souvent cités comme exemples précoces de jeux à visée pédagogique, bien qu’ils n’étaient pas toujours qualifiés de “serious games” à l’époque.
Le tournant s’opère au début des années 2000, avec une structuration de la filière. En 2002, le Department of Defense américain lance le jeu “America’s Army”, conçu pour le recrutement et la communication institutionnelle. Ce projet, financé par l’État fédéral, marque un moment fort : le jeu vidéo devient un outil officiel de formation et de communication.
En France, la notion de serious game commence à se diffuser à partir de 2004, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’industrie. Des universités, comme celle de Poitiers, ou des écoles d’ingénieurs intègrent progressivement ces dispositifs dans leurs parcours pédagogiques. En parallèle, des laboratoires de recherche en sciences de l’éducation et en informatique (LIMSI, LIP6…) commencent à étudier leur efficacité, légitimant leur place dans les environnements d’apprentissage.
Une reconnaissance internationale et multisectorielle
Depuis les années 2010, les serious games connaissent une véritable explosion. Ils ne sont plus cantonnés à l’éducation mais s’invitent dans la santé (simulation chirurgicale, rééducation), la formation professionnelle (soft skills, sécurité), la communication institutionnelle (citoyenneté, écologie), ou encore le recrutement.
Des événements internationaux comme le Serious Game Expo à Lyon (créé en 2005) ou le Games for Change Festival à New York (lancé en 2004) témoignent de la montée en puissance de ce secteur à l’échelle mondiale. Ces événements réunissent développeurs, chercheurs, formateurs et institutions autour d’un objectif commun : concevoir des expériences ludiques qui ont un impact réel.
En résumé, un serious game est bien plus qu’un simple jeu éducatif. C’est un outil à la croisée de plusieurs disciplines – pédagogie, psychologie, game design, technologie – qui s’est développé sur plusieurs décennies, dans des contextes variés. Son évolution reflète une volonté croissante de rendre l’apprentissage plus engageant, plus personnalisé et plus efficace.
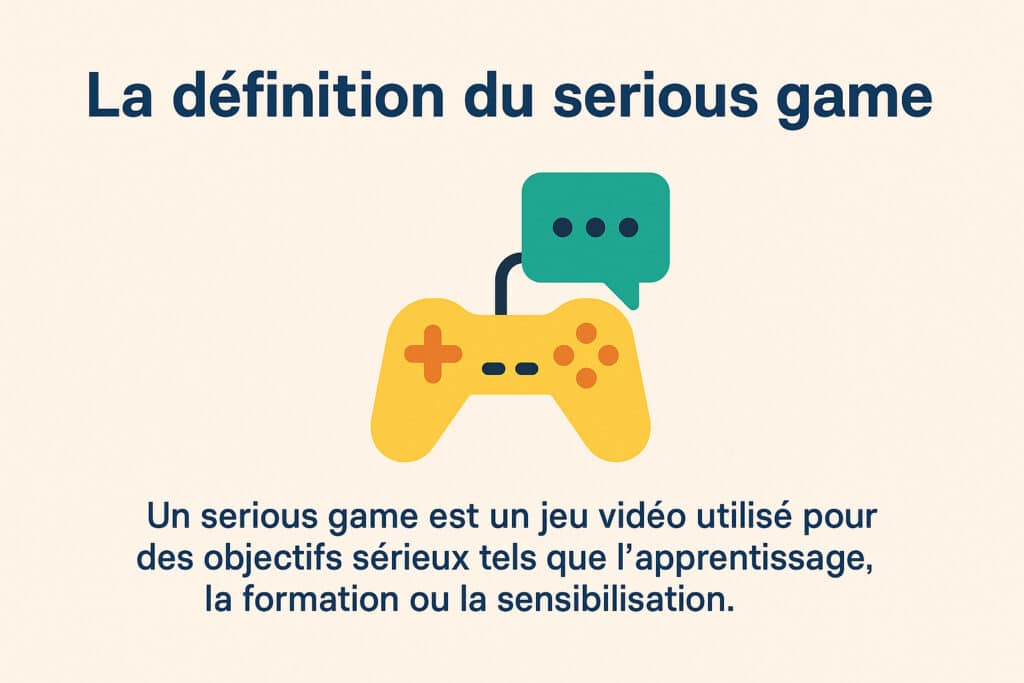
La motivation comme moteur de l’apprentissage avec les serious games
La motivation constitue l’un des moteurs essentiels de l’apprentissage. Sans elle, l’attention diminue, l’engagement s’érode, et la mémorisation devient fragile. Or, c’est précisément sur ce levier que les serious games s’appuient de manière particulièrement efficace, en combinant intelligemment deux formes fondamentales de motivation : la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque.
Motivation extrinsèque : le levier du jeu
La motivation extrinsèque repose sur des éléments extérieurs à la tâche elle-même, comme les récompenses, la reconnaissance sociale ou les sanctions. Dans les serious games, cette forme de motivation est activée par :
- les points accumulés à chaque bonne réponse ou bonne action, qui permettent de mesurer la progression ;
- les badges ou trophées, qui valorisent des accomplissements spécifiques et encouragent à poursuivre l’effort ;
- les classements, qui introduisent une dimension compétitive ou collaborative, selon les objectifs pédagogiques visés.
Ces mécanismes offrent un cadre clair et structurant, qui stimule l’implication immédiate des apprenants. Ils peuvent être particulièrement utiles dans les contextes où la motivation initiale est faible, comme dans l’apprentissage de compétences perçues comme rébarbatives ou complexes (comptabilité, sécurité, grammaire, etc.).
Mais cette motivation extrinsèque a ses limites : Si elle n’est pas soutenue par un intérêt réel pour le contenu, elle peut s’épuiser rapidement. C’est pourquoi le serious game ne se contente pas de récompenser ; il donne du sens à l’effort, en activant la motivation intrinsèque.
Motivation intrinsèque : L’envie d’apprendre par soi-même !
La motivation intrinsèque correspond au désir de s’engager dans une activité pour le plaisir qu’elle procure ou pour l’intérêt qu’elle suscite. C’est une forme de motivation plus profonde, plus durable, et plus étroitement liée à l’apprentissage en profondeur. Dans les serious games, elle est activée par plusieurs ressorts :
- la narration : une histoire immersive dans laquelle le joueur est acteur, avec des enjeux et des dilemmes à résoudre ;
- le sentiment d’autonomie : la liberté de choisir, d’explorer, de recommencer ;
- la maîtrise progressive : le plaisir de comprendre, de progresser, d’atteindre un niveau de compétence supérieur ;
- le sentiment d’utilité : l’impression que ce que l’on apprend a une application concrète dans la vie réelle.
Un bon serious game parvient à faire oublier à l’apprenant qu’il est en train d’apprendre. Il génère ce que le psychologue Mihály Csíkszentmihályi a appelé l’état de flow, un état de concentration maximale où l’on est entièrement absorbé par la tâche. Cet état est propice à un apprentissage en profondeur, car il mobilise pleinement les ressources attentionnelles.
Apports des neurosciences : motivation et apprentissage en action
Les apports des neurosciences confirment et précisent l’importance de la motivation dans le processus d’apprentissage. Les études en imagerie cérébrale ont mis en évidence le rôle des circuits dopaminergiques dans la motivation, en particulier ceux impliquant le striatum et le noyau accumbens. Ces zones sont activées lorsqu’une récompense est anticipée ou obtenue, même symbolique.
La dopamine, neurotransmetteur clé du système de récompense, favorise non seulement le sentiment de plaisir, mais aussi la consolidation de la mémoire. Elle agit comme un « marqueur de pertinence », signalant au cerveau que l’information est importante et qu’elle mérite d’être stockée durablement.
Ainsi, lorsque le joueur résout un problème, obtient un badge ou franchit un niveau, son cerveau libère de la dopamine, renforçant à la fois sa motivation et sa capacité à retenir ce qu’il vient d’apprendre. C’est ce lien entre émotion positive, engagement cognitif et mémorisation qui fait la force pédagogique des serious games.
Des contextes d’apprentissage renouvelés
Dans un environnement de formation professionnelle ou académique, les serious games apportent une réponse concrète à un enjeu souvent sous-estimé : comment maintenir la motivation des apprenants dans la durée. Là où des supports classiques (slides, vidéos, PDF) peinent parfois à susciter l’intérêt, le jeu introduit une expérience immersive et active qui redonne envie d’apprendre, même sur des sujets techniques ou réglementaires.
Par ailleurs, ils permettent de personnaliser le parcours d’apprentissage : selon ses choix, ses réussites ou ses erreurs, chaque joueur construit sa propre trajectoire. Cette individualisation, valorisante et responsabilisante, alimente à son tour la motivation intrinsèque.
L’engagement cognitif favorisé par l’interactivité et l’immersion
Un des atouts majeurs des serious games réside dans leur capacité à générer un fort engagement cognitif. Cet engagement ne se limite pas à un simple intérêt passager : Il implique une attention soutenue, un investissement émotionnel profond et une implication active de l’apprenant dans la construction de son propre savoir. C’est cet état de concentration dynamique qui favorise une assimilation plus efficace et plus durable des contenus.
Dans un cadre d’apprentissage classique, l’engagement peut être difficile à maintenir, notamment lorsqu’il s’agit de contenus abstraits, techniques ou peu contextualisés. Le serious game contourne cette difficulté en plaçant l’apprenant au cœur de l’action. Il n’est plus spectateur, il devient acteur. Il prend des décisions, fait des erreurs, corrige, avance, recule… en somme, il apprend en agissant, en expérimentant, en interagissant.
Des mécaniques de jeu pensées pour captiver et impliquer
Les concepteurs de serious games intègrent volontairement des éléments de gameplay qui vont capter l’attention et maintenir un haut niveau d’engagement mental. Voici quelques-uns des leviers les plus efficaces :
| Élément de jeu | Impact sur l’engagement |
|---|---|
| Scénario narratif | Stimule l’imagination et favorise la projection du joueur dans une situation concrète ; donne du sens à l’action pédagogique |
| Interaction dynamique | Permet au joueur de prendre des décisions qui influencent le déroulement du jeu ; renforce le sentiment d’autonomie et de contrôle |
| Feedback immédiat | Facilite l’ajustement des actions en fournissant une réponse directe ; encourage l’apprentissage par essais et erreurs |
| Défis progressifs | Maintient un niveau optimal de difficulté, évitant l’ennui lié à la facilité ou la démotivation liée à l’échec trop fréquent |
| Personnalisation de l’expérience | Permet à l’apprenant de suivre un parcours adapté à son rythme, ses erreurs et ses réussites ; augmente l’investissement émotionnel |
| Rétroactions narratives | Intègre les choix du joueur dans le déroulement du scénario ; rend l’histoire plus vivante et engageante |
Lorsque ces éléments sont bien intégrés, le joueur entre souvent dans un état de concentration optimale appelé flow, décrit par le psychologue Mihály Csíkszentmihályi. Dans cet état, l’individu est pleinement absorbé par la tâche, sans distraction ni lassitude. Cet engagement total est une condition idéale pour l’apprentissage en profondeur.
Une mobilisation des fonctions exécutives du cerveau
Les neurosciences cognitives apportent des éclairages précis sur ce que signifie “être engagé cognitivement”. Lorsqu’un apprenant est activement impliqué, ce sont les fonctions exécutives qui sont mobilisées : attention sélective, mémoire de travail, inhibition des distractions, planification, prise de décision.
Ces fonctions sont principalement localisées dans le cortex préfrontal, une région du cerveau essentielle à la régulation de l’apprentissage. Plus un individu s’engage activement dans une tâche, plus les connexions neuronales dans cette zone sont sollicitées et renforcées. Ce processus, connu sous le nom de plasticité synaptique, est à la base de la consolidation des apprentissages.
Le serious game, en favorisant une interaction constante avec l’environnement numérique, stimule en permanence cette activité cérébrale. Le joueur doit comprendre, anticiper, ajuster ses choix, analyser des situations complexes – autant d’actions qui sollicitent et développent des compétences cognitives transférables au-delà du jeu lui-même.
Une implication émotionnelle qui soutient l’apprentissage
L’engagement cognitif ne va jamais sans une forme d’implication émotionnelle. Dans un serious game, l’apprenant peut ressentir de la surprise, du stress contrôlé, de la satisfaction ou même de la frustration constructive. Ces émotions, loin d’être accessoires, jouent un rôle majeur dans la mémorisation et la motivation.
Les recherches montrent que l’émotion agit comme un catalyseur pour l’apprentissage. L’amygdale, structure cérébrale liée aux émotions, interagit avec l’hippocampe, qui est impliqué dans la consolidation de la mémoire. Ainsi, un contenu associé à une émotion forte (positive ou négative) aura plus de chances d’être retenu et rappelé plus tard.
Un serious game bien conçu intègre cette dimension émotionnelle : il crée des situations à enjeu, propose des choix avec conséquences, introduit des personnages auxquels on peut s’identifier. En rendant l’expérience plus humaine et plus engageante, il augmente significativement l’efficacité de l’apprentissage.
Un environnement propice à l’apprentissage actif
Enfin, le format interactif du serious game favorise un apprentissage actif, opposé à l’apprentissage passif souvent associé aux formats traditionnels (lecture, vidéo, écoute). Dans un jeu sérieux, l’apprenant n’est jamais en position d’observateur : il agit, expérimente, prend des décisions, et en assume les conséquences dans le cadre sécurisé du jeu.
Ce mode d’apprentissage, soutenu par de nombreuses recherches en sciences de l’éducation, permet de mieux ancrer les connaissances en créant des liens forts entre théorie et pratique. Il renforce aussi la confiance en soi, car chaque action réussie devient une preuve de compétence.
En résumé, l’interactivité et l’immersion offertes par les serious games ne sont pas de simples artifices technologiques. Elles constituent les fondations d’un environnement d’apprentissage riche, stimulant et profondément transformateur. En mobilisant à la fois la pensée, l’émotion et l’action, les serious games placent l’engagement cognitif au cœur du processus éducatif.
Un serious game permet la mémorisation renforcée par l’action et l’émotion
Un serious game bien conçu mobilise plusieurs canaux cognitifs simultanément : la vision, l’ouïe, le langage, la logique, mais aussi la motricité et les émotions. Ce traitement multisensoriel favorise une meilleure rétention des informations, en activant des zones complémentaires du cerveau. En combinant plusieurs modalités sensorielles et cognitives, le jeu multiplie les occasions d’ancrage mnésique. Les mécanismes de mémorisation activés sont multiples :
- L’apprentissage par l’erreur : en permettant au joueur de faire des choix, d’échouer, puis de corriger, le jeu met en œuvre une boucle de rétroaction qui facilite la mémoire procédurale. Ce type d’apprentissage est particulièrement efficace car il place l’apprenant dans une logique d’expérimentation concrète.
- L’ancrage émotionnel : des scénarios engageants ou des situations stressantes (contrôlées) stimulent l’amygdale, une zone cérébrale impliquée dans la mémoire émotionnelle. Cela crée des traces mnésiques plus profondes, car les souvenirs associés à une émotion forte sont mieux retenus et plus facilement rappelés.
- La répétition espacée : dans certains jeux, les mécaniques sont pensées pour revisiter régulièrement les notions apprises, ce qui correspond au principe de la spaced repetition, bien connu pour consolider la mémoire à long terme. Cette approche évite l’oubli rapide en réactivant les connaissances au bon moment.
Les neurosciences montrent également que l’apprentissage actif, c’est-à-dire celui où l’individu manipule, expérimente ou prend des décisions, entraîne une activité accrue dans l’hippocampe, structure essentielle pour la consolidation des souvenirs. Plus encore, cet apprentissage est souvent associé à une meilleure généralisation des connaissances, car il repose sur des expériences vécues plutôt que sur une simple exposition théorique.
En plaçant l’apprenant dans des situations simulées proches du réel, tout en sollicitant ses émotions et sa capacité d’action, le serious game offre un environnement particulièrement favorable à l’ancrage mémoriel. Il ne s’agit plus seulement de mémoriser une information, mais de la vivre, de l’expérimenter, et de l’intégrer durablement.



